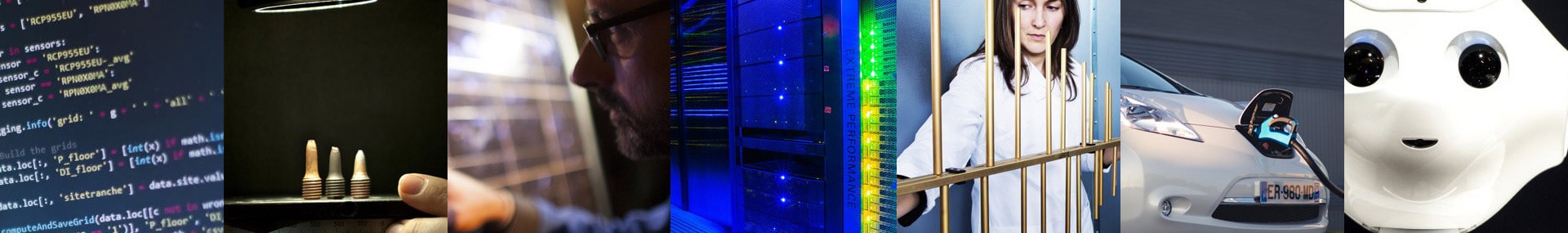L’optimisation, une compétence clé pour EDF au cœur du programme PGMO
Le programme PGMO rassemble des mathématiciens de tous bords sur un sujet majeur pour EDF : l’optimisation. Impliquant notamment l’Institut Polytechnique de Paris, ce partenariat original est fondé sur un programme de mécénat lancé en 2012 par EDF, sous l’égide de la Fondation Mathématique Jacques-Hadamard.
« L'optimisation a toujours été le terrain de rencontres académiques bilatérales », raconte Sandrine Charousset, initiatrice du programme en 2012. « Alors que nos besoins dans cette compétence grandissaient, nous avons monté ce programme afin de nous inscrire dans le long terme et d’ouvrir l'accès à d’autres équipes. »

Votre navigateur ne prend pas en compte le javascript.
Pour vous permettre d'accéder à l'information, nous vous proposons de consulter la vidéo dans un nouvel onglet.
La Fondation promeut l’excellence mathématique. Créée en 2011 sur le plateau de Saclay, elle offre un cadre idéal pour favoriser les synergies entre la recherche académique et industrielle. Rapidement, les principes de la collaboration se mettent en place : une participation sur la base d’appels à projets, une ouverture aux mathématiciens de tous les pays.
« Le PGMO permet de lancer des consultations portant sur la résolution de certains des grands problèmes (d’optimisation mathématique) auxquels EDF fait face, pour sélectionner des équipes de chercheurs intéressés par le sujet, explique Sandrine Charousset. Tous les résultats sont publics et n’importe qui, y compris EDF bien entendu, peut les exploiter. »
Les besoins en optimisation ont toujours existé mais plus le temps passe, plus les problèmes (d’optimisation) se complexifient. La transition énergétique à l’échelle européenne, avec les aléas liés aux énergies renouvelables, et la nécessité de prendre en compte différents vecteurs énergétiques, génère des problèmes gigantesques. C’est le terrain de l'optimisation stochastique, dans lequel on cherche à calculer des décisions optimales qui seront robustes aux incertitudes.
« Lorsque l’on souhaite simuler un système où la production d’énergie vient à 80-90 % des énergies renouvelables, cela donne une variabilité qui est énorme, décrit Sandrine Charousset. Comment intégrer dans nos problèmes d’optimisation le pilotage d’un très grand nombre de flexibilités (comme des batteries, ou des flexibilités sur des usages résidentiels) ? Nous décomposons le problème et nous lançons des travaux sur les différents sujets. »
Transition énergétique donc, mais aussi management d’énergie, compétition entre les acteurs des marchés de l’énergie, soutien aux métiers du Groupe… Les domaines d’investigation du programme sont nombreux. « EDF n’est pas en capacité de résoudre ces problèmes tout seul, reconnaît Wim van Ackooij, ingénieur chercheur expert à la R&D d’EDF et responsable de suivi du Programme PGMO côté d’EDF. La collaboration avec le monde académique apporte des solutions, des idées nouvelles, des algorithmes plus efficaces. »
Mais l’arrivée de nouvelles solutions n’est pas le seul avantage du programme. « Il attire des doctorants brillants qui produisent des thèses de qualité, estime Wim van Ackooij. Il démontre à la fois la vitalité de la recherche et la richesse des débouchés dans l’industrie, avec la possibilité de traiter de grandes questions de société. Ce sont à la fois des mathématiques « dures » et utiles. » Et les projets sélectionnés, soumis par des équipes de renommée internationale (de Saclay jusqu’à l’Ecosse ou à la Nouvelle‐Zélande…) permettent au PGMO de rayonner dans le monde entier.

La collaboration avec le monde académique apporte des solutions, des idées nouvelles, des algorithmes plus efficaces.

Le Programme PGMO
Le programme PGMO, Programme Gaspard Monge pour l'optimisation, la recherche opérationnelle et leurs interactions avec les sciences des données, est un programme de la FMJH, Fondation Mathématique Jacques Hadamard ouvert au mécénat.
Le PGMO couvre l’ensemble des thématiques relevant des Mathématiques de la décision, et notamment les thématiques suivantes : modélisation, optimisation continue, optimisation de grands systèmes, optimisation combinatoire et recherche opérationnelle, optimisation dans l’incertain, optimisation globale, théorie des jeux, programmation par contraintes et les thèmes en interactions : apprentissage statistique, sciences des données.
EDF, expert de longue date de l’optimisation mathématique
Le Groupe EDF peut s’enorgueillir d’une culture mathématique d’excellence et en particulier dans l’optimisation. « Les premières publications d’EDF sur l’optimisation remontent aux années 50 », raconte Sandrine Charousset. « À l’époque, il s’agissait d’optimisation des centrales, des barrages, de grandes infrastructures. »
Aujourd’hui, la R&D d’EDF a tellement développé cette compétence qu’elle a pu intégrer la théorie des jeux dans le pilotage de la grille et le calibrage des offres. « Cette théorie permet de traiter l’aspect multi-agents, de tenir compte de la réaction des clients pour fixer un prix, ou encore d’équilibrer la demande, décrit Stéphane Gaubert, directeur de recherche à l’Inria, travaillant à l’Ecole polytechnique, IP Paris et coordinateur du Programme PGMO. Son utilisation dans le monde de l’énergie est quelque chose de vraiment nouveau, intégrant aussi les avancées théoriques les plus ardues ».
« Certains de nos plus brillants esprits, comme le mathématicien Michel Gondran, qui a effectué toute sa carrière à la R&D d’EDF, ont publié des articles fondateurs dans ce domaine, abonde Wim van Ackooij. A ce titre, nous avons un vrai rôle d’animation la communauté scientifique. »
Le PGMO fédère en effet des compétences extrêmement diverses, « allant des matheux fondamentaux aux matheux appliqués et aux informaticiens», précise Stéphane Gaubert. « Son but est justement de permettre à ces esprits de tous bords de se parler. » Une rencontre a lieu annuellement pour permettre aux chercheurs de se retrouver physiquement, en plus de la collaboration quotidienne sur les divers projets.
Cet investissement d’EDF bénéficie à la discipline académique. « Nous avons suscité de nouvelles orientations de recherche », se félicite Wim van Ackooij. « Notre travail a permis de produire et diffuser de nouvelles connaissances académiques en optimisation mathématique » qui sont aujourd’hui reconnues par-delà nos frontières.
Idée reçue : dans la recherche, chacun travaille dans son coin
La vie des chercheurs est un mystère ; « on imagine volontiers des esprits libres, n’ayant de compte à rendre qu’à leur intellect, passant de longues heures à se battre sur un problème devant un papier tout en buvant de nombreux cafés reconnaît en souriant Stéphane Gaubert. C’est tout à fait vrai, mais, même sur des sujets fondamentaux, le progrès n’est souvent possible qu’en associant de tels efforts à une dynamique collective. A fortiori, dans des projets appliqués, ayant parfois une composante interdisciplinaire ou bien informatique, le travail en équipe est essentiel. »
Le PGMO illustre cette coopération multiforme, indispensable. D’abord entre l’industriel et l’académique. Ces derniers fournissent des cas d’études et des données dont les chercheurs sont friands. Des rencontres sont organisées - par le biais d’événements dédiés ou tout simplement de réunions de travail. La proximité physique des chercheurs et des industriels (par exemple, sur le plateau de Saclay) favorise aussi les échanges. La coopération peut aussi se comprendre générationnellement, après tout, les chercheurs d’aujourd’hui ne peuvent que s’appuyer sur les géants qui ont précédé. Comme, par exemple, Gaspard Monge, d'après qui le programme est nommé. Pour faire court : plus un arbre a de racines, plus qu’il est solide !
Enfin, la thèse, outil très utilisé dans ces partenariats, est un véritable travail collégial. « Même s’il est centré sur le travail du doctorant, celui-ci collabore avec son directeur de thèse, mais aussi avec les autres doctorants, les tuteurs industriels et les autres partenaires qui peuvent alimenter la thèse, précise Ange Caruso, Délégué Partenariats à la R&D d’EDF. Parfois la thèse fait aussi appel à d’autres compétences : sciences sociales, physique, chimie, etc. » En somme, dans la recherche, il existe toujours une bonne raison de collaborer.